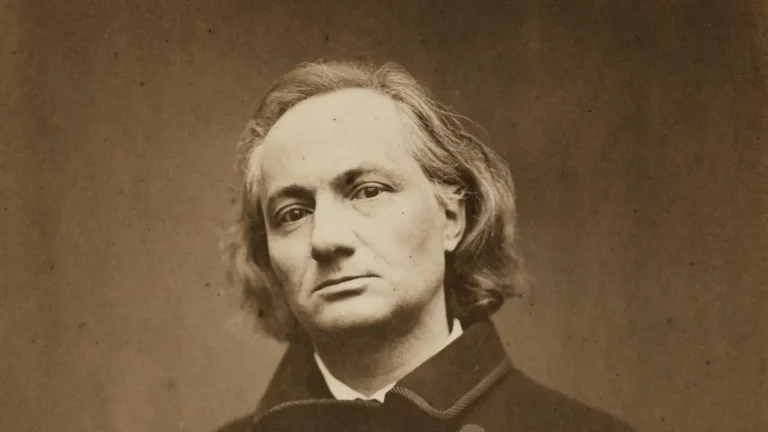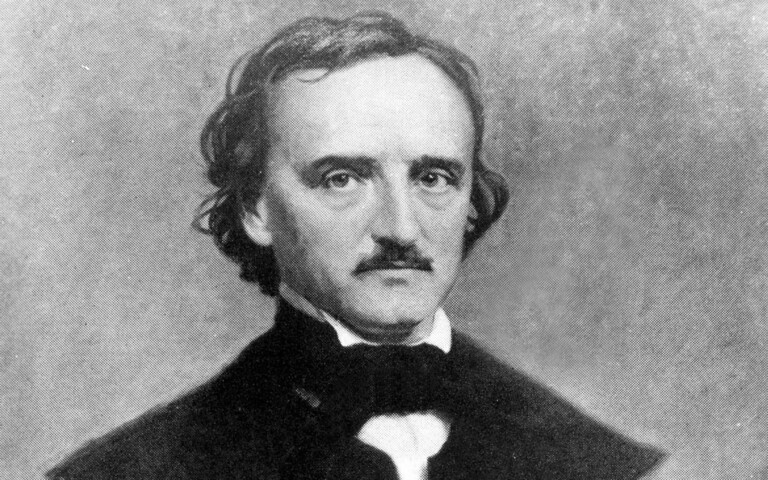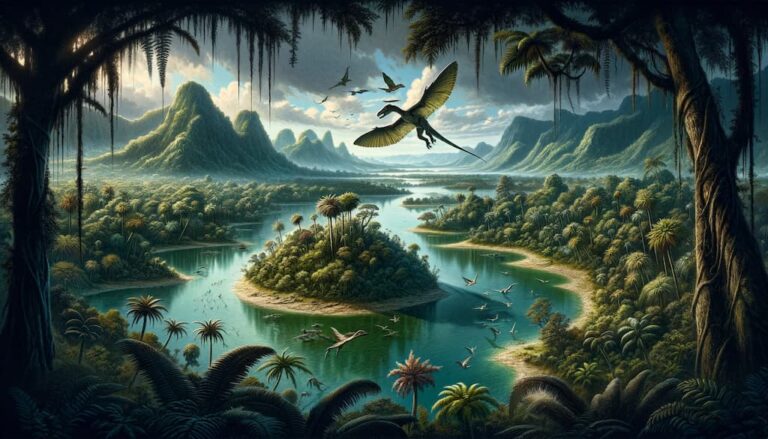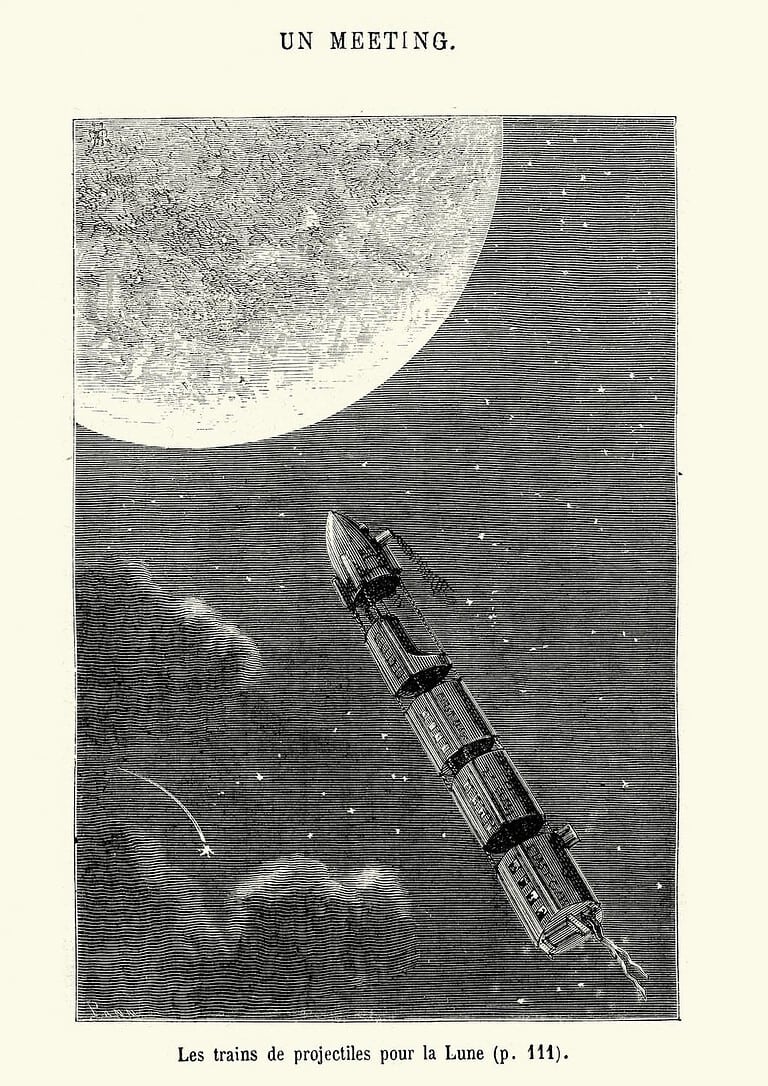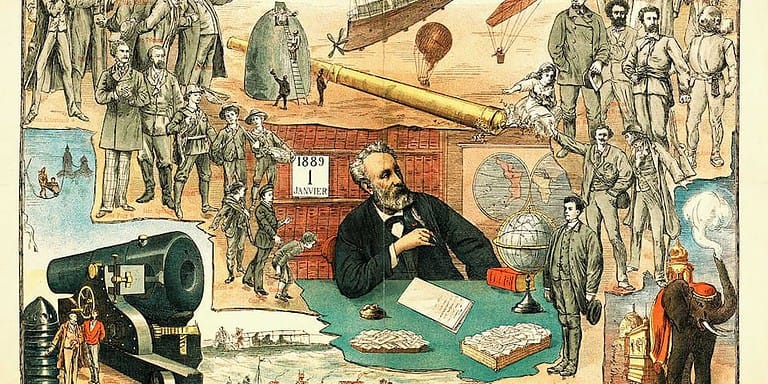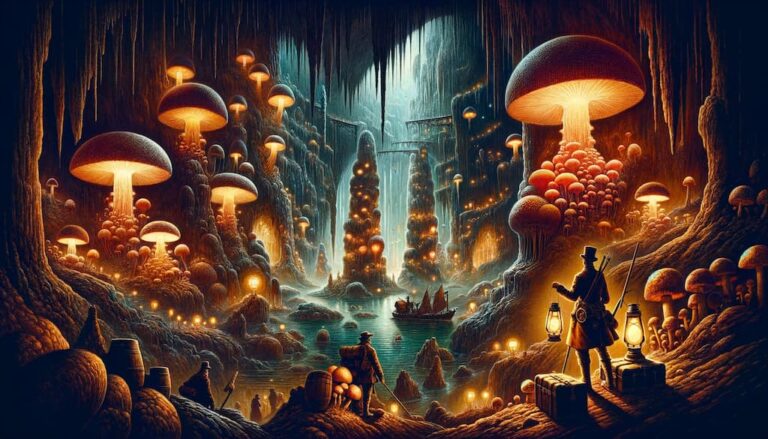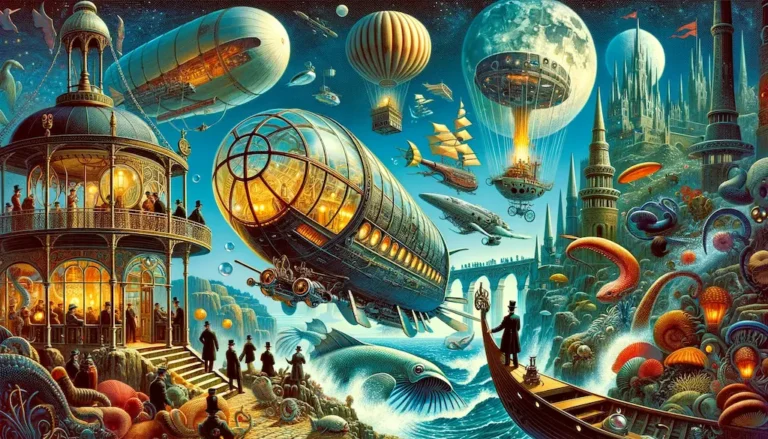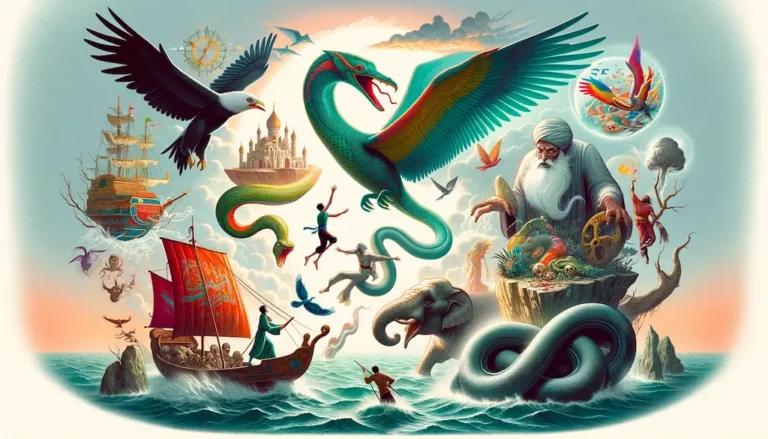There is no time and no place in which the Romans were free from Greek influence. [1]
A. Momigliano, Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico
Étudier le thème de l’influence grecque chez les premiers historiographes latins revient à s’intéresser au domaine de l’historiographie latine, genre littéraire qui, ainsi que son étymologie l’indique, consiste à écrire l’histoire. Le genre historiographique est mis en œuvre en premier lieu dans la littérature grecque et s’épanouit pleinement au Vème siècle avant notre ère par le biais des œuvres d’historiens grecs tels qu’Hérodote ou Thucydide, pour ne citer qu’eux.
L’historiographie apparaît donc comme un genre littéraire relativement ancien et qui répond à des codes, des techniques littéraires, une méthode d’écriture mis en place et développés en premier lieu par les historiens grecs. L’historiographie romaine, qui éclôt très tôt dans l’histoire de la littérature latine, jouit donc d’un profond héritage grec, ainsi que le montre E. Cizek: « on ne saurait envisager la formation et l’épanouissement de l’historiographie latine, en dehors de l’influence grecque [2] ».
Quand la littérature latine naît-elle ?
C’est en 240 avant notre ère que naît la littérature latine. Les premières œuvres littéraires sont composées par Livius Andronicus, esclave originaire de Tarente [3] : apparaissent ainsi des pièces théâtrales calquées sur le modèle grec, tant sur le plan scénique que narratif. Autour des années 230, l’auteur compose également l‘Odissia, épopée en latin et inspirée de l’Odyssée homérique. Telles sont les premières œuvres littéraires qui marquent le début de la littérature latine.
Par la suite, la plupart des œuvres qui succèdent à celles de Livius Andronicus présentent une particularité importante, dans la mesure où elles ont pour sujet l’histoire de Rome. Les œuvres historiographiques constituent donc une part capitale des premières œuvres de la littérature latine. La prégnance du genre historiographique dans les premiers moments de la littérature latine s’explique aisément par le contexte historique dans lequel elle naît.